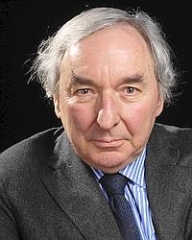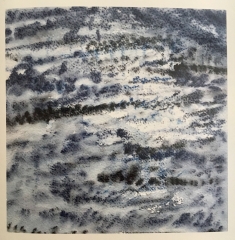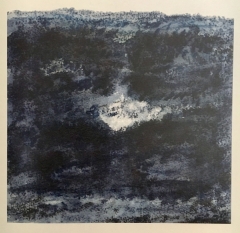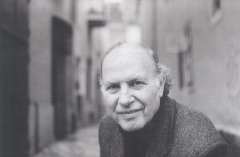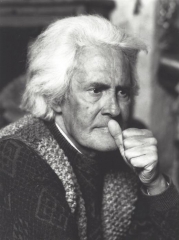Ginevra Bompiani, « Conseils à un chasseur »

DR
« À qui désire tuer un homme, j’aimerais rappeler que — par un étrange effet du crime — l’âge de la victime revient au meurtrier. Il faut par conséquent faire très attention à l’âge de celui qu’on tue. Tuez un nouveau-né, vous voilà faible, fragile comme lui : le premier venu peut vous empoigner et vous jeter par la fenêtre. Tuez un vieux, et la sève reflue avec vos forces, laissant flotter comme vide défroque un corps trop vague qui partout cherche appui, vos yeux se voilent, et la plus amoureuse des femmes s’esquive avec un haut-le-cœur. Si la victime est d’âge mûr, elle va se décharger sur votre dos du poids de ses années, des graves soucis de sa position, des souvenirs sans nombre d’une vie qui a mal tourné. S’il s’agit d’un jeune homme, au contraire, toute l’expérience que vous avez engrangée avec tant de peine, tombera à vos pieds, vos muscles céderont aux nerfs, vous vous empêtrerez, et le sens de l’orientation — si précieux à l’assassin que vous êtes — perdra sa sûreté, divaguera.
Veillez donc à bien choisir un homme arrivé au moment de sa vie qui soit le plus proche du vôtre. Même alors, quand vous vous trouverez devant un homme qui paraît le même âge que vous : méfiez-vous. Il pourrait cacher en lui toute une autre durée, invisible, n’avoir jamais accompli son âge, être dangereusement resté en deçà, ou l’avoir largement dépassé.
La race peut aussi vous jouer de mauvais tours : on dit que dans certains villages africains une gamine d’à peine douze ans vaut une fille épanouie de l’Europe ; qu’un homme de cinquante ans, là-bas, est déjà un vieillard. Cantonnez-vous à votre race. Et ne mésestimez pas — si vous êtes citadin — l’influence de la campagne : à chaque souffle du vent, le grand air touche à l’âge de l’homme : il lui fouette le sang et le rajeunit aujourd’hui, demain, à l’improviste il le couvre de rides.
Faites en sorte que la victime soit la plus proche de vous par l’âge, la condition, les habitudes, le physique. Et s’il vous arrive de rencontrer un homme aux cheveux noirs, les lèvres décolorées et le regard usé ; s’il porte un costume sombre, des chaussures à bouts ronds, pas de cravate ; s’il a trente-cinq ans, deux mois, deux jours ; s’il est né un samedi, dans une chambre en désordre, en émoi ; s’il cache une faute future ; s’il va le long du fleuve, juste en face de vous et que, vous bousculant à peine, il lève vers vous les yeux et pousse un cri d’horreur ; vous, qui savez à qui vous avez affaire, cet homme-là, vous pouvez tranquillement le tuer. »
Ginevra Bompiani
Les règnes du Sommeil
Traduit de l’italien par Eliane Formentelli
Postface d’Italo Calvino
Coll. « Terra d’altri », Verdier, 1986
https://editions-verdier.fr/auteur/ginevra-bompiani/
40 ans de Verdier