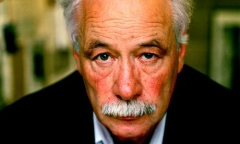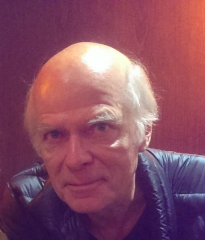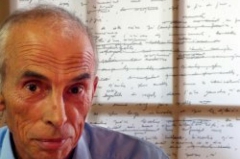« Après avoir loué une maison près de la porte de Dongzhi, j’ai aménagé ma bibliothèque dans une petite pièce à droite de la grande salle et, au-dessus de la porte, j’ai écrit ce nom, emprunté à Xu Wei : cabinet de l’Onde de la littérature.
Quelqu’un me dit : “La région de Guji n’est qu’un vaste paysage d’eau. Mais ici, à la capitale, le bruit et la poussière montent jusqu’au ciel et obscurcissent l’éclat du soleil. Il n’y a pas une goutte d’eau dans ce cabinet, comment imaginer y voir une onde ?”
Ermite de ce lieu, je répondis en souriant : “Il ne s’agit pas de la réalité de l’eau. Mais rien, sous le ciel, n’est plus proche de la littérature que l’eau. Elle part soudain tout droit, ou soudain change de cours. Elle couvre et découvre le ciel ; en un instant, une sombre nuée s’étend à l’infini. Ténue, c’est un voile de soie ; en tourbillon, c’est l’œil d’un tigre ; en cascade, c’est un rayon céleste ; dressée, c’est un mont de jade ; déployée, c’est un dragon ; éparpillée, c’est la brume ; inspirée, c’est le vent ; irritée, c’est le tonnerre. Rapide ou lente, nonchalante ou brusque, elle jaillit sous dix mille formes. Voilà pourquoi ce qu’il y a de plus prodigieux, de plus changeant sous le ciel, c’est l’eau. Né dans un pays d’eaux, j’ai été habitué à l’eau dès l’enfance, je vois de l’eau partout. J’ai traversé le Dongting, passé par la Huaihai, exploré le Taihu ; j’ai arrêté mon bateau au Yantan, visité les merveilles des Wu Xie, parcouru les plus beaux sites des fleuves et des lacs, épuisé toutes leurs métamorphoses. Et, après cela, je pense qu’il n’est pas, sous le ciel, d’eau qui ne soit littérature.
Depuis que je suis en poste à la capitale, je ferme ma porte et poursuis ma méditation. Ma poitrine se dilate comme lors d’une rencontre réelle. Tout ce que j’ai vu autrefois, vagues déferlantes, remous profonds et rides de surface, est soudain devant moi. Je prends alors un livre, de Qian, Gu, Fu, Bai, Yu, Xiu, Xun ou Shi et, à mesure que je lis, l’eau déploie devant moi toutes ses fantastiques métamorphoses. Elle se ramasse dans une gorge, se roule dans des vagues, chante dans une source, se dilate dans une mer, se déchaîne dans une cascade, se recueille dans un étang. Tout ce qui est souple et sinueux est eau. Toute littérature, pour moi, est eau. Une montagne, haute ou basse, si elle est belle ou gracieuse, sans doute est-elle aussi littérature ; mais ce qui est haut ne peut s’abaisser, ce qui est raide ne peut charmer, c’est chose morte. L’eau, non. Aussi l’âme de la littérature et celle de l’eau sont-elles une seule et même chose sous leur apparence différente. Voilà pourquoi je ne vois, dans ce cabinet que de l’eau. Les fleuves et les mers se succèdent jour après jour devant mes yeux. Si vous ne le comprenez pas, c’est que vous avez l’esprit borné. Qu’y a t-il à redire à ce nom ? »
Yuan Hongdao (1568-1610)
La dynastie des Ming in Anthologie de la poésie chinoise
Traduit par Martine Vallette-Hémery
La Pléiade/Gallimard, 2015