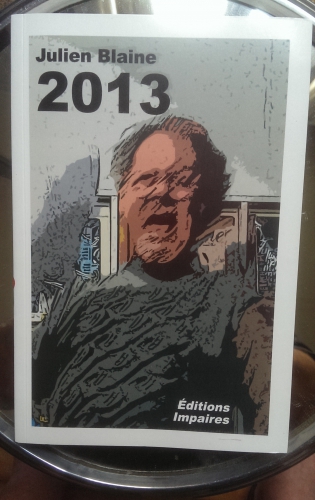« On ose à peine le dire, mais c’est vrai : personne ne connaît le français, hors les Français eux-mêmes. Un Anglais sur deux lit le français, ils sont nombreux à le parler, d’aucuns l’écrivent et ils sont quelques-uns à prétendre – et qui les contredirait ? – que c’est la langue de leurs rêves. Mais pour connaître une langue il faut l’avoir oubliée, et c’est là une étape que l’on ne peut atteindre si l’on n’a pas inconsciemment absorbé les mots dès l’enfance. Lorsque nous lisons une langue qui n’est pas la nôtre, notre conscience en éveil attire notre attention sur le chatoiement superficiel des mots, mais jamais elle ne tolère qu’ils s’enfoncent dans cette région de l’esprit où de vieilles habitudes et des instincts enfouis, en les tournant et retournant, leur façonnent un corps bien différent de leur visage. C’est ainsi qu’un étranger possédant ce que l’on appelle une maîtrise parfaite de l’anglais peut écrire un anglais grammatical et un anglais musical – il écrira souvent, en vérité, tel Henry James, un anglais plus raffiné que celui des indigènes – mais jamais un anglais si inconscient que nous y sentions le passé du mot, ses associations, ses attaches. Il y a une bizarrerie dans chacune des pages que Conrad a écrites. Individuellement, les mots sont justes, mais leur assemblage a quelque chose d’incongru.
Donc, bien que le nombre de livres français lus chaque année par des Anglais soit sans doute très élevé, l’interprétation de ces livres, si on la soumettait aux critiques français, semblerait souvent étrangement loin du compte. De même, il est toujours amusant de voir ce qui plaît au goût français dans la littérature anglaise, ou de recevoir de leurs critiques quelque version étrange, un rien bancale, de réputations anglaises, quelque vision brillante mais fantaisiste du caractère anglais. L’extrême brio des vies de Shelley et de Disraeli racontées par M. Maurois provenait en partie de la nouveauté dont il les dotait. Une nouveauté d’autant plus frappante qu’il y avait là sans doute un grain de vérité masqué par la coutume.
C’est la nouveauté, et l’étrangeté, et le fait même que nous soyons conscients et non pas inconscients qui font de la lecture de livres français une habitude si répandue chez les Anglais, qui rendent la littérature française si stimulante, si revigorante, si neuve pour nos esprits. »
Virginia Woolf
Sur les inconvénients de ne pas parler français
traduit de l’anglais par Christine Le Bœuf
précédé de Bravez l’interdit par Alberto Manguel
Coll. Le cabinet de lecture, L’Escampette, 2014