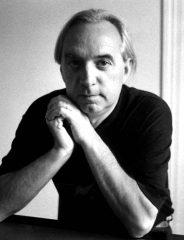Bernard Delvaille, « Blanche est l’écharpe d’Yseut »

« À Tintagel
les roses meurent aussi
Un pan de mur
un papier de soleil
quelques mètres carrés de neige
et ce ciel bleu
quand il rentre au matin
avec sur lui
une odeur de garçon
Il oublie tout
né il y a trop longtemps
Il a froid
les anges sont blessés
Ses lèvres sont deux oiseaux
Le mort
qui par sa bouche
du foutre jette encore
c’est lui
Des bruits sourds
dans la nuit
martèlent son cerveau
Il s’endort la main
sur la couverture glacée du livre
prêtant serment
et les draps froids
sont le linceul
préparé pour l’absence
qui est séparation
comme fleur coupée
en vase
au vol des guêpes
funéraires
Mais où dis-tu
qu’il s’est enfui
a-t-il respiré
l’odeur des feuilles
l’appel du matin
quand l’enfance qui n’est pas
ne sera jamais
quand tout serait à naître
mais s’écroule comme
sous le poids du lierre
le mur
Les dieux peut-être
les avaient
l’un à l’autre promis
Désormais
que savent-ils
de ce sommeil interrompu
de ces falaises de la chair
d’où l’on se jette
à l’aube
mordant les draps les lèvres
léchant sur le ventre de l’autre
le sperme de l’enfance
miel dont se nourrissent
ceux qui ne naîtront pas
Que savent-ils de cet instant
où tout se brise où tout
se donne en glace
au jeu du soi et du non-soi
À être un seul
en deux visages
sur les flots
à ne savoir quel est le vrai
on invente ses blessures
ses travestis
Quand vient le bal
on n’est plus deux
mais un motard
aux lèvres peintes
assassin aux yeux faits
vidant sa vie tel un moteur
avant le gel
Et cet enfant
qui n’est pas né
ce frère en l’herbe chaude
est-ce à toi qu’il eût ressemblé
est-ce à moi
Je l’entends dans la nuit
qui marche
et me retourne
quand son pas cherche
à me rejoindre
C’est le poids de mon ombre
cet enfant dont les yeux
ne se sont pas ouverts
qui n’eut pour toute chambre
qu’un ventre de chair et de sang
et un tombeau
Ô laissez-moi je vous en prie
lui tendre le premier rameau
d’aubépine
et partir avec lui
avec toi dans la nuit
des eaux vives
brisé
fidèle à cette image
inconnue
est-il toi
es-tu lui
et
moi
toi
nul ce chemin
qui longe la mer
interlocutrice
dans les ajoncs
Sais-je
ce que de moi il attendait
de celui qui
à sa place
vivrait
qu’il ne connaîtrait pas
Vacant
d’inusité
dans l’aurore glacée
attendre
attendre encore
la barque
qui le ramènerait
si »
Bernard Delvaille
Blanche est l’écharpe d’Yseut
Les Cahiers des brisants, 1980
réédition in Poëmes (1951-1981), Seghers, 1982