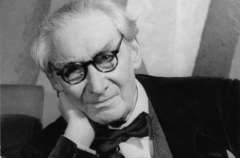Juliette Mézenc, « Elles en chambre »

« Parce que si on écrit de tout son corps… qu’en est-il des auteurs qui écrivent avec un sexe de femme ? Le sexe ne fait-il vraiment rien à l’affaire, comme le proclamait Monique Wittig : “on est écrivain ou pas” ? Nombreuses aujourd’hui sont les femmes qui écrivent, et c’est sans précédent, la littérature s’en trouve-t-elle modifiée ? Sachant par ailleurs qu’entre Barbie et sa rivale Bratz la guerre désormais fait rage, comprendre qu’elles se portent comme des charmes, que les moules sexués semblent loin bien loin d’être brisés, qu’en est-il de la femme qui écrit, échappe-t-elle à son genre ?
Parce qu’écrire c’est s’arracher, faire cette tentative de bondir hors des frontières, celles assignées par la nationalité, le genre, l’espèce, hors des murs de l’identité qui délimitent trop souvent le territoire d’un moi étriqué et mesquin, hors de ce que l’on croit connaître, savoir, hors des formes répertoriées qui ronronnent, partir ! Le travail, quelle belle chose parfois ! et parce que c’est en poïeinant et en se réjouissant de poïeiner qu’on pourra faire la nique à tous ceux qui nous coupent de cette sauvagerie, ils sont légion (poïeinerie, n.f. du grec poiein “faire, fabriquer, produire, créer” qui a également donné poiêma puis poème, bref : poïeinerie = travail sauvage et irrécupérable).
Parce que je crois sentir, encore, malgré tout, dans ma bouche, parfois, le fantôme de Scold’s bridle*…
Parce qu’heureusement Virginia Woolf**… »
Juliette Mézenc
Elles en chambre
L’Attente, 2014
* Scold’s bridle est un dispositif de punition utilisé en Écosse puis en Angleterre jusqu’au xixe siècle à l’encontre des femmes dont le discours était jugé « médisant », « séditieux » ou « gênant ». Il s’agissait d’une muselière de en fer avec un mors, souvent garni de pointes, qui prenait appui sur la langue.
** Une chambre à soi est une conférence que Virginia Woolf a donnée à des étudiantes de l’Université de Cambridge sur les conditions matérielles et culturelles de la création.