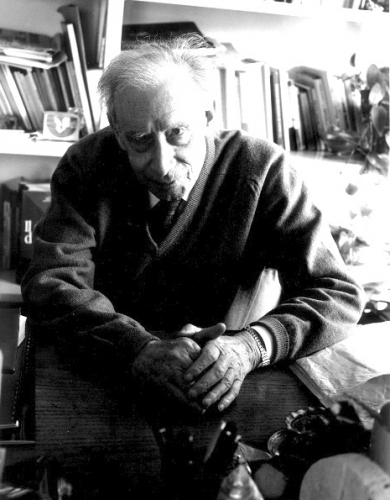Camillo Sbarbaro, « Lettre du bistrot »

« En état de grâce, ami Volta,
je t’écris d’une gargote la nuit.
État de grâce : car je ne connais plus grand
bien que de contempler
à travers la brume du vin les paysages
dont l’art grossier orne les murs tout autour,
et l’hôtesse moustachue ou la grosse
fille rieuse qui apporte la terrine.
Se mettre à discuter avec son voisin
de hasard ; à celui qui sourit
sourire, aimer tout le monde ;
affranchi du Temps et de l’Espace,
considérer le monde comme le bon dieu.
Et sortir de la gargote léger
comme la montgolfière qui s’envole ;
sentir sous son pied incertain les pavés
comme des tapis de velours ;
et avoir envie de chanter à tue-tête.
Dans le monde changé, je me pilote,
navire qui dévie, jusqu’au port habituel.
Fuite des chats devant le pas sourd.
Arrogant rectangle de lumière
dans la ruelle bruissante de fantômes.
Au carrefour, âcre odeur de chlorure.
En cela je me refais, ami Volta.
Et comme il ne m’est jamais donné d’aimer quelqu’un,
je m’agrippe aux choses comme un naufragé.
Combien de fois ai-je regardé comme une issue
les navires qui sortent du port !
New York, Calcutta, Londres : noms immenses.
Je rêvais de me perdre là, d’être un autre,
d’oublier jusqu’à mon nom.
Maintenant même cette illusion est tombée :
ma lâcheté pèse à mon pied
comme le boulet de plomb au forçat.
Et ainsi passe ma vie,
objet de pitié pour vous, de rire
pour les autres ;
et il me suffit de susciter l’accord
de mes magnanimes amis, les ivrognes…
Jusqu’à ce qu’il fasse jour, j’espère, et que je sorte
d’ici d’un pas ferme et m’achemine
vers quelque place vide, quelque eau sombre
de fleuve…
Ami, je sais qu’aujourd’hui Vénus
te tient à sa merci.
Réjouis-toi ! Ton sang
court plus vigoureux dans tes veines,
ta gorge se serre, et ton cœur quelquefois
cesse de battre comme dans la mort.
Mais si le temps doit venir – que jamais il ne vienne –
où il ne reste du feu que la cendre,
alors toi, viens chercher l’ami.
Tu le trouveras à la taverne dont les vitres
ont des petits rideaux rouges déteints
avec écrit pour enseigne : AU GROS GODET.
Je ne te demanderai pas de tes nouvelles ni des siennes.
Je pousserai vers toi le verre plein
pour qu’en silence avec l’ami boive
l’oubli. »
été 1913
Camillo Sbarbaro
Pianissimo, suivi de Rémanences
Traduit de l’italien par Bernard Vargaftig, Bruna Zanchi et Jean-Baptiste Para
Préface de Guiseppe Conte
Clémence Hiver éditeur, 1991