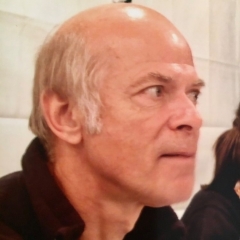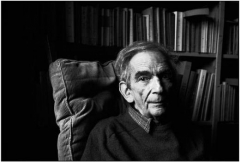Jean de la Croix, « Chanson entre l’âme et l’époux 1 à 12 »

« I
Épouse
Mais où t’es-tu caché
me laissant gémissante mon ami ?
Après m’avoir blessée
tel le cerf tu as fui,
sortant j’ai crié, tu étais parti.
2
Pâtres qui monterez
là-haut sur les collines aux bergeries,
si par chance voyez
qui j’aime dites-lui
que je languis, je souffre et meurs pour lui.
3
Mes amours poursuivrai,
j’irai par les montagnes et les rivières,
les fleurs ne cueillerai,
ne craindrai lions, panthères
et passerai les forts et les frontières.
4
Demande aux créatures
Ô forêts et taillis
que mon ami a de sa main plantés,
verdoyantes prairies
de fleurs tout émaillées,
dites si parmi vous il est passé.
5
Réponse des créatures
Mille grâces versant,
en hâte par ces bois il est passé
et en les regardant
son visage a jeté
sur eux le vêtement de la beauté.
6
Épouse
Ah, qui me guérira !
Achève enfin d’entièrement t’offrir,
ne me dépêche pas
d’envoyés pour me dire
ce qui ne peut répondre à mon désir.
7
Et tous ceux-là qui errent
me vont de toi mille grâces évoquant
et tous plus me lacèrent
et me laisse mourante
je ne sais quoi qu’ils vont balbutiant.
8
Mais comment vivre encore,
âme, là où tu vis ne vivant pas,
et faisant pour ta mort
les traits que tu reçois
de ce qu’en toi de l’ami tu conçois ?
9
Pourquoi l’ayant meurtri,
n’as-tu pas soulagé le cœur blessé
et, me l’ayant ravi,
pourquoi l’avoir laissé
sans emporter ce que tu as volé ?
10
Mon tourment, éteins-le
puisqu’à l’apaiser nul ne suffira
et que te voient mes yeux
car tu es leur éclat
et je ne veux les avoir que pour toi.
11
Cristalline fontaine,
si, parmi tes visages argentés,
tu figurais, soudaine,
les yeux si désirés
qui sont dans mes entrailles dessinés.
12
Ami détourne-les,
le vol me prend
Époux
Colombe, reviens-moi,
voici le cerf blessé
qu’au tertre on aperçoit,
qui au vent de ton vol s’aère et boit. »
Jean de la Croix
Cantique spirituel
traduit de l’espagnol par Jacques Ancet
in « Thérèse d’Avila, Jean de la Croix, Œuvres »
édition de Jean Canavaggio
Pléiade / Gallimard, 2012