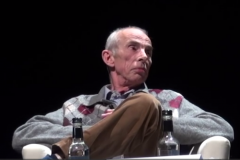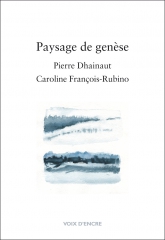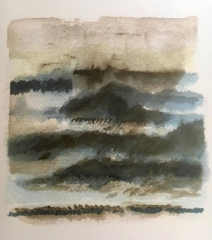DR
« Mon corps nu
Assis dans un bain public je me lave soigneusement tout le corps, ce n’est pas seulement parce que je ne me suis pas lavé d’une ou deux semaines.
Une vie ! J’ai vécu jusqu’à ce volume de mon corps !
Semblable à un bol en argile, il est fragile.
Cependant, je me demande ce que j’ai mis à l’intérieur ?
Y vivais-je ? Comme les eaux que le volume de mon corps fait couler hors de la baignoire ?
Seul le mensonge m’a façonné.
Extrême jalousie intellectuelle. Complexes. Plaisir de me montrer.
C’est le résumé d’une trentaine d’années de vanité,
Haletant, j’ai franchi la ligne du milieu.
Ainsi, s’il était en vie, il aurait à peu près mon âge
Jeon Tae-Il, un saint.
Ma vie a été frappée et découverte par l’éclair de sa courte vie. Laide. Honteuse. Déshonorée.
Son tonnerre arrive tardivement à moi, à cet âge là.
Ma jeunesse foudroyée ! J’étais sous le paratonnerre.
Moi. J’étais là.
Je n’avais pas le choix, c’étaient les aléas de la vie.
Ce qui existe en moi, c’est une petite agriculture muette.
Il est peut-être au pied d’une forêt à l’abri du vent de Bukpyeong dans la commune Sinwol qu’il ne pouvait plus quitter,
Et peut-être mesure-t-il le terrain avec la visière d’un chapeau de Saemaeul appartenant à Monsieur Yun ?
Ou bien, pouvait-il traverser la colline voisine Doam,
Voulait-il devenir le potier qui met les pots au feu ?
Sinon était-il un menuisier ou un plâtrier silencieux avec un caractère difficile ?
Ah ! Il est sorti en ville, à cause de son manque de sérieux, peut-être est-il devenu terrassier ?
Ou peintre de panneaux de cinéma, surveillant dans une usine textile, ouvrier des chemins de fer.
Suivant la veine bleu foncé de la vie glaciale,
Il aurait dû embraquer au marché de Pyeonghwa à Cheongaecheon. Marchand de bois, vendeur de chewing-gums, vendeur de journaux.
Il aurait dû être brocanteur. Derrière la gare, au bord de la rivière noire, en extrême pauvreté, il restait debout, l’estomac vide depuis trois nuits et quatre jours.
Et l’égout amer déborde abondamment dans mes viscères.
Les globes de mes yeux ardents aperçoivent les œufs rouges des vers intestinaux volant sur le ciel bleu.
J’avais la tête qui tournait. Dans mes vertiges, j’ai vu père, mère, frère aîné, frère cadet, toute la famille.
Chacun était orphelin. Après le départ de mon frère aîné qui s’est engagé dans l’armée,
En comptant les traverses, j’ai marché jusqu’au sud de Kwangju pour ramasser les escarbilles de charbon.
Un train de marchandises chargé à bloc roulait vers Yeosu.
Plus bas que le pire dénouement, je suis arrivé devant la barrière. Au feu rouge,
Je restais debout. Oh ! les jours de misère !
Dans ce monde sombre, j’étais face à ma vie, mais
J’ai tenu tous ces jours pour rien. La confession m’ennuie.
Comme tous les autoportraits sont affreux, j’ai retrouvé le plein air où vivre.
Plusieurs affluents obscurs ont coulé en moi.
Avaient coulé. Coulent.
Maintenant mon corps est nu.
Ma main touche mon corps. Me voici.
Si on enlève de plus en plus la crasse, la vie devient transparente.
Les traces de faucille, de couteau, la plaie sur mon genou quand je suis tombé de vélo,
Grandissaient avec mon corps.
Je tourne la tête, comme moi, des corps nus étaient là, avec quelques seaux d’eau, chacun nettoyant sa vie en face.
Oh ! Corps nus ! Tous les “moi” sont absents en ce moment.
Mais je n’ose pas encore demander à quelqu’un de me laver le dos.
Tenant un gant italien, je me suis approché du dos d’un vieillard.
De mon propre dos, je n’y arriverais pas. »
Hwang Ji-U
De l’hiver-de-l’arbre au printemps-de-l’arbre — cent poèmes
Traduits du coréen, présentés et annotés par Kim Bona
Prélude, Claude Vigée
William Blake & Co. Edit, 2006
http://www.editions-william-blake-and-co.com/spip.php?article1031578