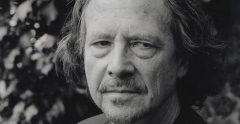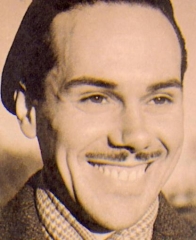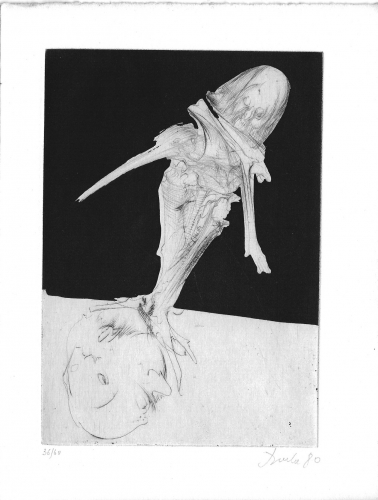Camille de Toledo, « L’inquiétude d’être au monde »
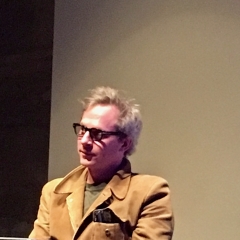
© CChambard
« Je pense au visage d’Anna Magnani dans un film de Pasolini. Nous sommes près de Rome dans des terrains vagues. La mère observe son garçon assis sur un manège. Pendant les quelques secondes où elle ne le voit pas, Ettore se lève. Il descend du manège en marche. Puis… le manège tourne encore. Là où il était assis, il ne reste que l’effroyable vide de l’enfant disparu. Il s’est levé, il est parti, mais la mère n’en sait rien. À ce moment, les yeux de la mère ! Son gamin a disparu, il lui a été volé. C’est ce qu’elle pense, ce que disent ses yeux. Elle se met à courir. Elle crie : Ettore ! Ettore ! Si proche de Terrore ! Terreur des instants minuscules, d’une mort inimaginable. La mère court après son propre effroi. Elle court après sa peur. Puis, au bout de quelques mètres, elle le voit. Ettore ne s’est pas envolé, pas encore. Il marche gentiment sur un chemin qui s’appelle : ennui. Les bras le long du corps. Les pieds à la traîne. Dégaine familière du gosse. La mère s’apaise. L’inquiétude la quitte, mais pour combien de temps ?
*
Voici ce que je nomme : inquiétude.
Veille et terreur qui ne cessent de grandir en nous.
Quiétude que nous espérons,
mais qui nous quitte au fil de l’âge.
Impossible apaisement
dont nous portons le souvenir.
*
C’était il y a longtemps.
Il y a si longtemps, pense-t-on.
Dans un monde d’hier, comme le titre de Zweig :
Le Monde d’hier. Lorsque l’homme était au centre,
la ville autour de lui, et plus loin, maîtrisée, paisible,
la nature, le cycle régulier des saisons.
Cette quiétude passée est à peine un souvenir.
Un âge rêvé qui ne fut sans doute jamais,
mais comment le dire autrement ?
Devrait-on dire : ce fut là notre enfance ?
Ou plus loin encore, le souvenir
d’un âge de la pensée qui se perpétue en nous.
Âge de l’équilibre, de la raison.
Souvenir de ce que l’esprit de l’humanisme
portait comme conscience et espoir.
C’était ça : un monde bien ordonné.
*
L’inquiétude est le nom
que nous donnons à ce siècle neuf,
au mouvement de toutes choses dans ce siècle.
Paysages ! Villes ! Enfants !
Voyez comme plus rien ne demeure.
Tout bouge et flue.
Paysages !
Villes !
Enfants ! »
Camille de Toledo
L’inquiétude d’être au monde
Coll. « Chaoïd », Verdier 2010
https://editions-verdier.fr/auteur/camille-de-toldedo/
40 ans de Verdier