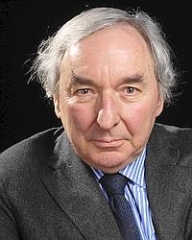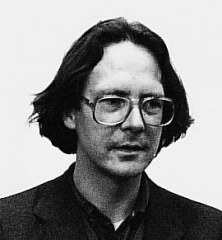« Au bord du marais
Promeneur dans le vent noir ; les roseaux secs chuchotent doucement
Dans le calme du marécage. Au ciel gris
Passe un vol d’oiseaux sauvages ;
Diagonale sur les eaux sombres.
Tumulte. Au fond d’une cabane délabrée,
La pourriture aux ailes noires prend son envol ;
Des bouleaux rabougris gémissent dans le vent.
Soirée dans une auberge abandonnée ; sur le chemin du retour
S’attarde la douce mélancolie des troupeaux qui paissent.
Apparition nocturne : des crapauds sortent des eaux argentées.
Traduction Henri Stierlin
Rêve et folie & autres poèmes
suivi d’un choix de lettres traduites par Monique Silberstein & de Crépuscule et anéantissement par Jil Silberstein
GLM, 1956, rééd. augmentée Héros Limite, 2009
Au bord du marécage
Voyageur dans le vent noir ; doucement murmure le roseau mort
Dans le silence du marécage. Dans le ciel gris
Suit un passage d’oiseaux sauvages ;
Diagonale au-dessus d’eaux obscures.
Tumulte. Dans la hutte en ruine
Bat de ses ailes noires la pourriture :
Des bouleaux atrophiés soupirent au vent.
Soir dans la taverne abandonnée. La douce mélancolie des troupeaux en pâture
Imprègne le chemin du retour,
Apparition de la nuit : des crapauds émergent d’eaux argentées.
Traduction par Marc Petit & Jean-Claude Schneider
Œuvres complètes
Gallimard, 1972
Au bord du marais
Errant dans le vent noir ; dans le calme du marais
Murmurent les roseaux morts. Dans le ciel gris,
Suit un vol d’oiseaux sauvages ;
De biais au-dessus des sombres eaux.
Tumulte. Dans la hutte défaite
S’élève sur ses ailes noires la pourriture ;
Des bouleaux estropiés gémissent dans le vent.
Soir dans la taverne abandonnée. La douce tristesse des troupeaux du pacage
Enveloppe le chemin du retour,
Apparition de la nuit : des crapauds surgissent des eaux argentées.
Traduction Eugène Guillevic
Quinze poèmes
Illustrations d’Étienne Lodeho
Les Cahiers d’Obsidiane, 1981