Patrick Varetz, « Sous vide »

DR
« Tout peut s’oublier, à commencer par la douleur. Vos gestes – allez savoir pourquoi – se font avec le temps moins spontanés, les mots vous jaillissent moins facilement. On dirait qu’une fine paroi de corne vous pousse sous la peau, dans l’intention de la doubler secrètement. Quelque chose, en vous – isolé du monde, infiniment petit dans les replis du ventre –, consent à se taire, et vous apprenez simplement à vivre avec cette gêne permanente. Patiemment, pendant des années, on plante en vous des cris et des insultes, on vous ouvre les yeux sur la férocité de vos semblables, et le malheur – celui des autres, justement – s’installe en vous à demeure, ce qui empêche certaines images – parmi les plus inacceptables – de continuer de vous hanter durant votre sommeil. Les frayeurs et les tensions s’accumulent au point de s’annuler. Ce phénomène de la douleur, au fond, s’apparente – mais à plus vaste échelle – à celui du tartre qui va se loger derrière les dents. On s’en accommode sans mal, bien heureux encore de s’y écorcher la langue de temps à autre. Ainsi je porte en moi, tel un avorton, l’agglomérat de mon salaud de père et de ma folle de mère, et leur douleur à tous deux – quoique oubliée en partie, presque niée – est là qui me cimente, et me fait tenir d’une seule pièce malgré la dislocation annoncée de mon existence. Je ne veux pas voir le chaos qui se jette sous mes pas, ni cette mauvaise route au bord de laquelle – au sortir de l’adolescence – j’abandonne mes parents. Renoncer à affronter la réalité qui se présente, c’est tout autant refuser de regarder en arrière. L’excédent de salive, dans ma bouche, se charge à la longue d’une saveur métallique, fade à mourir. Je voudrais cracher, me retourner l’estomac, mais je ne dispose plus du ressort nécessaire pour me révolter. La douleur, au terme de cette expérience, se résume à une nausée sourde dont il serait vain de vouloir se débarrasser. »
Patrick Varetz
Sous vide
P.O.L, 2017





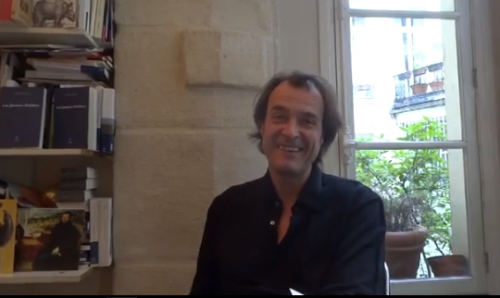



 Roger Laporte est mort le mardi 24 avril 2001. Il avait soixante-seize ans. Son œuvre est considérable. Nous devons continuer à la lire, à y trouver des nourritures pour le voyage qui nous reste à faire. Il m’avait confié le manuscrit de ce livre, Écrire la musique, que je suis fier d’avoir publié et de continuer à vendre bon an mal an à quelques poignées d’exemplaires, preuve qu’il y a encore des lecteurs pour ce travail — cette vie — d’écriture à nul autre comparable. On trouvera l’essentiel des textes de Roger Laporte — La Veille, Une voix de fin silence, Pourquoi ?, Fugue, Supplément, Fugue 3, Codicille, Suite et Moriendo — dans le volume Une vie, publié par P.OL. en 1986.
Roger Laporte est mort le mardi 24 avril 2001. Il avait soixante-seize ans. Son œuvre est considérable. Nous devons continuer à la lire, à y trouver des nourritures pour le voyage qui nous reste à faire. Il m’avait confié le manuscrit de ce livre, Écrire la musique, que je suis fier d’avoir publié et de continuer à vendre bon an mal an à quelques poignées d’exemplaires, preuve qu’il y a encore des lecteurs pour ce travail — cette vie — d’écriture à nul autre comparable. On trouvera l’essentiel des textes de Roger Laporte — La Veille, Une voix de fin silence, Pourquoi ?, Fugue, Supplément, Fugue 3, Codicille, Suite et Moriendo — dans le volume Une vie, publié par P.OL. en 1986.