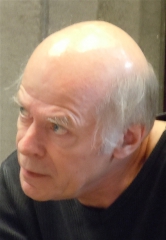Lu Yu, “Le vieil homme qui n’en fait qu’à sa guise”

étudiant les livres
à l’écart je me suis réfugié, au bord des fleuves et des lacs,
séjournant sagement au milieu du vent et de la pluie
le papier neuf à la fenêtre est extrêmement blanc
dans le poêle chaud le feu rouge vif rougeoie
marque-pages et étuis de livres je viens à l’instant d’arranger
la prononciation et la forme des caractères j’étudie en détail
si je ne meurs pas tout de suite et surmonte la décrépitude,
pendant dix années encore je me consacrerai à l’étude
Lu Yu
Le vieil homme qui n’en fait qu'à sa guise
traduit du chinois par Cheng Wing fun & Hervé Collet
Moundarren, 1995
en remerciant Lambert Schlechter depuis Eschweiller