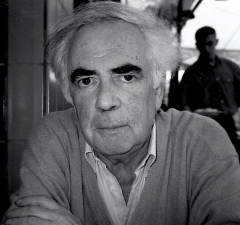« D’aucuns disent que l’amour est un petit garçon,
D’autres disent que c’est un oiseau,
D’aucuns disent qu’il fait tourner le monde,
D’autres disent que c’est absurde,
Et quand je demandai au voisin,
Qui feignait de s’y entendre,
Sa femme se fâcha vraiment,
Et dit qu’il ne faisait pas le poids.
Ressemble-t-il à un pyjama,
Ou au jambon dans un hôtel de la ligue anti-alcoolique ?
Son odeur rappelle-t-elle les lamas,
Ou a-t-il une senteur rassurante ?
Est-il épineux au toucher comme une haie,
Ou doux comme un édredon pelucheux ?
Est-il dur ou plutôt souple sur les bords ?
Ô, dis-moi la vérité sur l’amour.
Nos livres d’histoire en parlent
Avec des petites notes ésotériques,
C’est un sujet assez ordinaire
Sur les navires transatlantiques ;
J’ai vu la question traitée
Dans le récit de suicides,
Et je l’ai même vu griffonné au dos
Des indicateurs de chemin de fer.
Hurle-t-il comme un berger allemand affamé,
Ou gronde-t-il comme une fanfare militaire ?
Peut-on l’imiter à la perfection
Sur une scie ou sur un Steinway ?
Chante-t-il sans freins dans les réceptions ?
N’apprécie-t-il que le classique ?
Cessera-t-il quand on veut la paix ?
Ô, dis-moi la vérité sur l’amour.
J’ai regardé dans la maison de vacances ;
Il n’y était même pas ;
J’essayai la Tamise à Maindenhead
Et l’air tonique de Brighton.
Je ne sais pas ce que chantait le merle,
Ou ce que disait la tulipe ;
Mais il ne se trouvait ni dans le poulailler,
Ni sous le lit.
Peut-il faire des mimiques extraordinaires ?
Est-il souvent malade sur la balançoire ?
Passe-t-il tout son temps aux courses,
Ou gratte-t-il des bouts de cordes ?
A-t-il une opinion sur l’argent ?
Pense-t-il assez au patriotisme ?
Ses plaisanteries sont-elles vulgaires mais drôles ?
Ô, dis-moi la vérité sur l’amour.
Quand il viendra, viendra-t-il sans avertissement
Au moment où je me gratterai le nez ?
Frappera-t-il à ma porte un beau matin,
Ou me marchera-t-il sur les pieds dans l’autobus ?
Viendra-t-il comme le temps change ?
Son accueil sera-t-il aimable ou brutal ?
Bouleversera-t-il toute mon existence ?
Ô, dis-moi la vérité sur l’amour. »
W. H. Auden
Dis-moi la vérité sur l’amour
Traduit de l’anglais par Gérard-Georges Lemaire
Christian Bourgois, 1995
Repris, suivi de Quand j’écris je t’aime, traduit par Béatrice Vierne, Points / Seuil, 2009