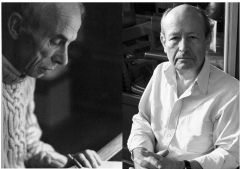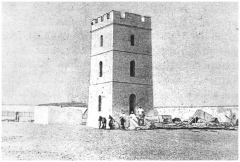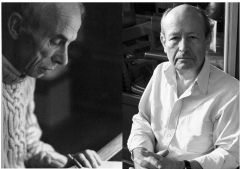
DR
« 07.XII.07
Mon cher Pierre,
D’aucune manière tu ne dois douter de ceci : nos livres nous auront gardés ce que nous sommes dans les pires incertitudes du temps, si inconfortables qu’il ait pu nous être donné de les connaître. Au moins n’aurions-nous jamais « écrit rien que de nécessaire, chacun de notre côté, et quasi depuis l’enfance “montant sur toute chose comme sur un cheval”. Peut-être, qui sait ? n’aurons-nous eu, même, à choisir en rien la manière ni le moment, si persuadés, pourtant, que nous ayons été toujours du contraire ? C’est ainsi. À peine nous est-il donné de l’entrevoir. Est-ce à dire que nous serions fondés à formuler maintenant des regrets ? Tu sens comme moi le ridicule qu’il y aurait à ces plaintes. Nous aurions fait face à ce qui venait, que nous ne pouvions ni soupçonner ni connaître, comme il en aura toujours été, et pour nous — par la patience et par l’action, si malheureuses puissent nous apparaître rétrospectivement quelques-unes de nos mésaventures. N’aurons-nous pas eu, aussi le meilleur de ce qui pouvait nous être donné de meilleur ? L’élan, le feu, l’audace, la vie aveugle jetée sans calcul dans la fournaise ? Vois : la vie vivante tremble dans chacune de tes pages. Chacun de ceux qui, une fois, les aura approchées l’aura su. Ce feu n’aura plus de fin, j’en prends le pari sans crainte.
Pour ce qui est de la “vie nouvelle” de la dernière carte, c’est très simple : si tu as un instant envisagé avec sérieux, calme et terreur ta fin physique la plus tangible, et que, très sûr de la fin, ayant même en idée pris tes dernières dispositions, fait tes adieux, tu te découvres imprévisiblement muni d’un peu de vie encore, tu auras trouvé à celle-là un autre goût, une autre teneur — ceux-là nouveaux, avec nécessité, qui te donnent à sentir une bonne fois tout l’incroyable d’être — une autre fois.
Je t’embrasse
Jean-Paul
[…]
Gif, mercredi 8 février 2012
Mon cher Jean-Paul,
Ce qui nous est arrivé, sans qu’on y ait trop de part, aura été mémorable. Il fallait le porter sur le papier, poétiquement ou prosaïquement, selon les moyens disponibles, le fixer, le clarifier, et d’abord à nos propres yeux. Des gueux, enlevés par le mouvement historique à leur relégation millénaire, à l’autarcie, à la stupeur, ne peuvent plus ne pas se demander ce qui leur arrive et qui s’inscrit, en dernier recours, dans le plan général. Ç’aura été fatigant mais stimulant, aussi. Toujours, me reste le souvenir de l’énergie que tu y as mise d’entrée de jeu, et le poème dont elle empruntait spontanément la voie, et le choix de la philosophie ! Je me répète : ce qui s’est passé était sans précédent et “n’aura point de suite”. C’est arrivé une seule et unique fois, et c’est toi que cette heure entre toutes les heures a désigné dans notre petite troupe de réprouvés. J’ai vu ça. J’étais là.
Urbinati était avec moi en primaire où il dessinait déjà. J’ai connu Serge Viallard dès la sixième mais non pas Christian Lacreu.
Er c’est plein de tristesse que j’ai dactylographié nos retrouvailles en 2008 avec Daniel. Il semblait, et c’était fou, que nous revenions en conscience au commencement. Je retrouvais les iconoclastes, les casseurs d’assiettes avec lesquels le sort m’avait mis, moi, rêveur, bénin, en relation. Et c’était la fin. Déjà !
Je ne te savais pas Treignacois par la branche maternelle. Te voilà donc un Corrézien complet, du haut et du bas pays, avec, à l’arrière plan, la grande plaine orientale et les hordes mandchoues. J’y pense. Catherine a des attaches, aussi, vers Treignac. À celui de Sermédiéras, qui se trouve près d’Uzerche, a dû s’ajouter un autre campement de yourtes, avec des têtes coupées accrochées au mât central, dans les Monédières, mais il n’a pas laissé de nom, juste des physionomies. […]
Je te serre sur mon gros blouson fourré.
Pierre »
Pierre Bergounioux, Jean-Paul Michel
Correspondance 1981-2017
Verdier, 2018
https://editions-verdier.fr/livre/correspondance/