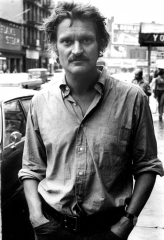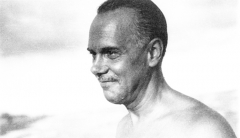DR
« III
Dans une cage à grillons chinoise
nous avons gardé un temps le bonheur
enfermé. Les pommes de paradis prospéraient,
splendides, il y avait plein d’or
sur l’aire de battage, et tu disais
que la nuit il fallait veiller sur le fiancé
comme sur un clerc. C’était plus souvent carnaval
pour les enfants. Il y avait dans le ciel
des petits nuages en forme d’agneau. Les amis
venaient déguisés en Ormuz
et Ahriman. Mais ensuite il y eut, inattendue,
cette histoire à propos du monsieur
élégant de l’Opéra, et je trouvai
un orvet dans le poulailler.
Une corneille en volant perdit une plume
blanche, le curé, messager
boiteux en pardessus noir,
apparut seul le matin du Nouvel An
sur le vaste champ de neige.
Depuis nous nous armons
de patience, depuis le sable
s’écoule par la boîte aux lettres,
les plantes en pots ont une drôle de manière
de garder le silence. Une tragédie
nordique, coups d’échec et coups en coin,
nécessairement s’accomplit toujours
la fin. Pourquoi faut-il qu’on s’évertue
à une entreprise aussi difficile ? Le malheur
d’autres gens reste comme consolation
jaune poisson au chapeau de la bien-aimée,
et pourtant il était si beau naguère.
Prose du siècle dernier,
une robe qui s’est prise
dans les chardons, un peu de sang, une
exaltation, une lettre déchirée,
une petite étoile d’uniforme et d’assez longues
stations à la fenêtre. Des rêveries
mauvaises dans une chambre
obscure, des péchés ressassés,
des larmes même et dans la mémoire
des poissons un feu mourant,
Emma en train de brûler
son bouquet de mariée. Que peut bien se dire alors
un pauvre médecin de campagne ? Aux funérailles
il rêve d’une paire de bottes vernies
étincelantes et d’une séduction
posthume. Mais maintenant vient
un temps sans couleur. Toi, au milieu
de l’obscénité aveuglante,
je vais me rappeler ton œil
apeuré, tel que je l’ai vu
pour la première fois,
à Haarlem le jour où
le flot nous emporta par une brèche dans la digue.
Anniversaires et nombres,
comme tout cela est loin,
un tableau plein de lettres à peine
déchiffrables à travers les lentilles
de verre. En fait, j’entends
la petite opticienne chinoise dire en fait,
vous devriez maintenant pouvoir
lire cela facilement, et l’espace d’un instant
je sens le bout de ses doigts
sur mes tempes, je sens
une onde traverser
mon cœur, et je vois dans le carré
lumineux de l’image-test
alignées les lettres
YAMOUSSOUKRO, le nom,
je le sais pertinemment, d’un
grand bateau rouillé
d’Abidjan, qu’il y a des années
j’ai vu un jour sortir
du port de Hambourg.
Des matelots noirs étaient
accoudés au bastingage.
Ils faisaient signe au passage,
le soleil se couchait,
et les ombres déjà
tremblaient
sur leurs bords. »
W. G. Sebald
D’après nature – Poème élémentaire (1988)
Traduit de l’allemand par Sibylle Muller et Patrick Charbonneau
Actes Sud, 2007