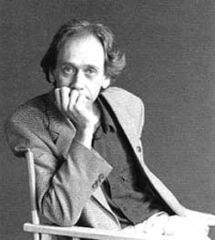Jacqueline Merville, « Juste une fin du monde »

« J’ai un corps qui attend sans cesse que je l’emmène loin du massacre, loin du supplice. Il est devenu dans la nuit au bord de la lagune africaine le lieu de la mort. Il sait qu’il va mourir, il sait la mort. Il sait vraiment que mourir lui appartient. Je demeure avec lui dans la peur. Une peur vaste et obscure et très ancienne. Elle évoque l’épaisseur de la vase, pas sa substance, une vase faite d’air onduleux, compact, sans origine ni fin. Une autre respiration est là, ni animale ni humaine, une respiration qui ressemble à l’ordre tourmenté des étendues cosmiques. Je ne refuse pas cette peur, elle est comme une compagne. Avoir peur est devenu un seuil, un pointillé charnel vers du sacré. Je ne sais lequel. J’ignore ce qui viendra ou ne viendra pas avec la mort du corps. Le corps se souvient parfois de quelque chose d’aérien, de plein, d’une délivrance, d’une éternité peut-être. Il accepte alors sa dissolution, sa totale disparition. Puis cela s’efface très vite, comme un rêve, un effleurement auquel il ne s’accroche pas.
Le savoir de ce corps vulnérable, supplicié, menacé, et pourtant encore vivant, pourrait donner une saveur joyeuse à chaque instant de vie, à chaque jour. Sa peur pourrait se déplacer, s’écouler comme un fleuve, traverser l’inconnu, la lumière ou l’absence de la lumière. Mais il ne le fait pas, il préfère attendre, faire le gué, repousser l’instant de sa dissolution. Il préfère me donner l’ordre de survivre, de gagner du temps. Je l’écoute comme le lieu, le seul, qui soit le mien. Il a toujours su plus que je n’ai appris avec les livres, avec la rencontre de gens remarquables. »
Jacqueline Merville
Juste une fin du monde
L’Escampette, 2008
le site de Jacqueline Merville : https://sites.google.com/site/jacquelinemerville/home
Trente-deuxième page pour fêter les vingt ans de L’Escampette