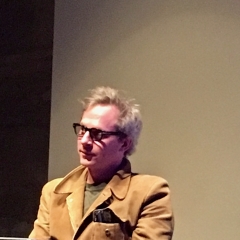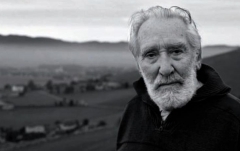Sylvie Fabre G., « Pays perdu d’avance »

« Quand la lumière tombe,
la mère que tu portes sur les épaules
de l’écriture pour toucher de sa présence
le ciel garde sa réserve spirituelle,
le bonheur des jours créés ensemble.
*
Quand la lumière tombe,
tes mots emplis de larmes sont l’horizon
et le centre. Leur sel, de naissance, demeure
fidèle à celle qui t’a précédée jusque
dans le poème, tout-petit nouant l’attache.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Enfant, mère, montagne et nuages suspendus,
l’arbre s’éloignait.
L’oiseau avait semé le désir du départ de l’autre côté
mais de son passage nulle preuve,
juste le cri blanc de la disparition.
(Je me souviens)
Venue du Grand Pays l’hirondelle,
pays perdu d’avance,
son trait d’encre et le vide où encore je m’oublie
me font écrire
comme les mots qui ne savent rien et l’inventent.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Qui parle pour dire la présence ?
Dans le ciel et l’ombre du ciel sur la terre
telles les saisons les mères passent,
et les mots. Pour ne pas oublier
peut-être n’avons-nous qu’une voix
du berceau au tombeau.
De la mémoire m’arrivent des fragments,
maison sous le Vercors, lampes et livres,
vieilles femmes, jeune mère, autant de
noms qui peuvent s’accorder à l’enfance
mais le père, le lilas et l’oiseau, les douleurs,
les extases, comment les recouvrer ?
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Peut-être la dernière nuit, celle notre mort,
ne contient-elle que les souvenirs de vie vivante
éparpillés dans la suite du temps, un défilé, et
derrière la clôture des yeux, contre la poitrine
des mères, ces enfants sans âge dont bruissent
les ailes aux bords oubliés du Grand Pays.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(Je me souviens)
Dans la bibliothèque de ma mère les livres
étaient comme des lampes que je tenais dans mes mains,
que je levais vers le ciel bleu de rien, qui est tout.
Ils me rendaient chaque contrée visible
traversant le temps l’ici et l’ailleurs
pour retourner à la première éternité dont ils venaient.
Jour et nuit mains tendues dans le mystère,
je suivais le grand fleuve des mots qui remontaient
de l'estuaire vers la source pour fertiliser
mes fondations. Et j’épousais leur abondance:
il y avait en eux l’appel et le cri pour la vie,
en eux le cri et l’écho pour la mort.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
La mère qui s’en va, l’oiseau qui s’envole
dans la bibliothèque maintenant déserte
les livres et leurs mots vieillissent avec l’enfant,
l’amour toujours les habite, et le perdu.
Dans le poème il est possible
que le perdu soit son chant d’éternité. »
Sylvie Fabre G.
Pays perdu d'avance
Peintures de François Rebeyrolle
L'Herbe qui tremble, 2019